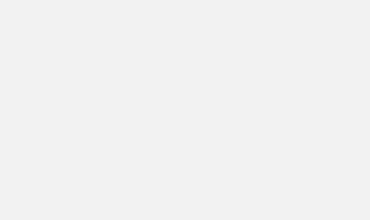Cette année à Cannes, on a chanté, porté des masques chirurgicaux, repensé la figure du toxic male, dessiné, croisé des fantômes…
Macron et la France
La surreprésentation du cinéma français dans cette édition marquée par la crise sanitaire, donc par une moindre circulation internationale des films liée à la réticence de certaines délégations étrangères (notamment américaines et asiatiques), a déjà beaucoup été commentée. Les sept films français de la compétition, auxquels s’ajoutent six autres dans la nouvelle sélection Cannes Première, font quasiment figure de main basse de Thierry Frémaux sur le cinéma d’auteur hexagonal.
Mais au-delà du quantitatif, c’est la matière de ces films qui laisse à l’esprit un sujet France inhabituellement mis au centre. Alors que le cinéma national est souvent accusé de ne pas regarder son propre pays dans les yeux au présent, il a cette année complètement contredit ce cliché. Signe troublant, trois films font apparaître Emmanuel Macron : à la télévision dans La Fracture de Catherine Corsini (sur les Gilets jaunes et la crise des hôpitaux), en conférence de presse selon un montage gaguesque qui le fait virtuellement dialoguer avec Léa Seydoux dans France de Bruno Dumont (télévision d’actu à grand spectacle), et a la télévision également dans Municipale de Thomas Paulot.
Si on ajoute Retour à Reims de Jean-Gabriel Périot, se dessine un cinéma français qui filme et questionne obsessionnellement le pouvoir en place, parce qu’il n’a sans doute plus le luxe de pouvoir le laisser hors champ : la fracture sociale qu’il cause est partout et tous les documentaires comme aussi les fictions finissent par la trouver sur leur chemin.
>> À lire aussi : “France”, un brûlot déchaîné contre l’info télé sensationnaliste
Le covid
Si le covid-19 a été omniprésent dans les travées du festival avec les rumeurs infondées d’un cluster, le port du masque et le pass sanitaire, la façon dont l’épidémie a modifié notre réalité n’était finalement pas tellement présente dans les films. En compétition, celui qui a le plus pris en charge cette modification le fît malgré lui. En racontant une nuit de folie dans un centre hospitalier surchargé par les blessé·es venus d’une manif de Gilets Jaunes. Dans La Fracture de Catherine Corsini, ne figure pas directement le covid, mais sa façon d’orchestrer le chaos et le point de rupture de l’hôpital public, où une bonne prise en charge des patient·es n’est plus possible, fait très fortement penser à la crise sanitaire que nous avons vécue.
L’autre grand film covid du festival était à la Quinzaine. Il s’agit de Journal de Tûoa de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro, qui met en abyme ses conditions de tournage, en confinement et avec la peur de la contamination. On porte également des masques dans Tralala des Frères Larrieu (et d’ailleurs pas seulement sanitaires, le personnage principal masque aussi son identité). Damien Bonnard refuse avec éclat de porter un masque dans une boulangerie dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Enfin, deux épilogues de films prennent eux aussi acte du monde d’après. Si dans Drive my car, on voit simplement un personnage faire ses courses en portant un masque, le plan panoramique final et éblouissant du film de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre (Rien à foutre) raconte la façon dont l’épidémie permet une domestication toujours plus oppressante des corps.
Mâles toxiques
Identifier dans la fiction des mâles toxiques, des pervers narcissiques et autres prédateurs qui s’ignorent est devenu une des grandes affaires de la réception des films et des séries ces dernières années, et quoi qu’on puisse en penser, force est de constater que le cinéma lui-même s’en saisit désormais en masse. Ce qui varie, c’est le caractère plus ou moins refoulé, ou volontaire, ou encore parfois opportuniste de la chose. Chez Carax, l’écriture du toxic male revendique son ambiguïté, provoque violemment (jusqu’au féminicide), mêle indistinctement le vrai et le faux et désoriente avec une virtuosité mêlée de folie notre rapport au personnage de Henry, joué par Adam Driver. Sean Baker, lui, décrit un mâle assez irrésistible, auquel on aimerait tout pardonner en dépit de son comportement de véritable salaud, manipulant toutes les femmes qui croisent sa route jusqu’à faire miroiter à une adolescente un rêve empoisonné de carrière porno.
Tre Piani, à l’inverse, paraît prendre le parti d’un père de famille accusé de viol par une jeune femme qui s’est pourtant offerte à lui, semblant placer assez grossièrement son curseur sur l’idée d’une persécution des honnêtes hommes par une sorte de conspiration féminine. Audiard, dans Les Olympiades, fait lui encore la preuve de son goût bien connu pour les mâles alpha briseurs de cœurs, mais s’oblige désormais à les regarder du point de vue d’un portrait féminin sensible. Titane, enfin, assume une approche frontale du sujet dans son premier acte porté par une recherche de pure jouissance vengeresse sur la figure du mâle toxique, avec sa première scène gore à forte inspiration rape and revenge. Les approches varient du tout au tout, mais un constat se confirme à chaque fois : plus aucun personnage masculin ne peut vraiment échapper au soupçon.
>> À lire aussi : [Cannes 2021] “Titane” : une Palme d’or inattendue et audacieuse
Homosexualité féminine
La forte présence des récits d’amour lesbiens apparaissait comme une réponse à une masculinité toxique, autre grande thématique d’un festival qui aura offert des visions très contrastées sur les relations amoureuses et sur le couple. Dans Les Olympiades de Jacques Audiard, comme dans Benedetta, l’amour lesbien est l’endroit de l’émancipation et de la conquête. Dans le film de Paul Verhoeven, c’est la naissance du désir pour une femme (Daphne Patakia), puis sa réalisation, qui active chez la nonne Benedetta (Virginie Efira) un autre désir, celui d’une prise de pouvoir. Dans d’autres films du festival, l’amour entre filles n’avait pas, chose rare et réjouissante, vraiment valeur de refuge puisqu’il ne faisait ni débat, ni sujet. C’est le cas de La Fracture de Catherine Corsini, de Compartiment 6 de Juho Kuosmanen, de Titane de Julia Ducournau ou encore du beau premier long métrage de Charline Bourgeois-Tacquet, Les Amours d’Anaïs dans lequel Anaïs (Demoustier), après différentes expériences hétérosexuelles, s’éprend de la femme (Valéria Bruni Tedeschi) de son ancien amant.
Mères absentes
Aux habituelles figures de pères absents dont on ne compte plus les personnages souffrants et sublimes qui ont fait le cinéma, venaient s’additionner, dans cette édition, celles déjà existantes, mais moins fournies, de mères disparues (Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre ; Les Olympiades de Jacques Audiard), absentes (France de Bruno Dumont ; Aline de Valérie Lemercier), punies de ne pas être assez bonnes (Red Rocket de Sean ; Annette de Leos Carax) ou au contraire “victime” de leur sainteté (Bonne Mère d’Hafsia Herzi). Deux films eux, Bergman Island de Mia Hansen Løve et Serre moi fort de Mathieu Amalric, mettaient en scène la même actrice, Vicky Krieps, pour une redéfinition et un réajustement de cette place de mère, écartée du centre pour devenir l’une des composantes du portrait d’une héroïne en fuite, libre d’être tout à la fois.
Couple et création
Comment créer et vivre à deux et au sein du couple hétérosexuel a été l’une des grandes questions que se sont posées les films de cette édition 2021 (Julie en 12 tableaux, Drive my car, Tromperie). Si Annette faisait démarrer cette réflexion par la réponse la plus sombre et dramatique qui soit (une féminicide), Bergman Island lui rétorqua quelques jours plus tard par la belle émancipation de son héroïne. Tandis qu’Aline offrait une vision idéalisée en portraitisant avec humour et tendresse le couple Céline-René. Bien souvent teintés par la remise en cause des inégalités hommes-femmes, ces films mixant velléités créatrices et relations amoureuses ont déployé cette thématique dans la fiction, mais aussi en dehors. Deux des films les plus réussis de cette édition ont été réalisés en couple, c’est Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre et Journal de Tûoa de Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes.
L’enfant-pantin et le bébé-machine
Le festival s’est ouvert par l’irruption d’Annette, une drôle de petite fille, figurée pendant 90 % de son temps de présence à l’écran par une marionnette. De façon si littérale qu’elle en devient puissamment poétique, Leos Carax exprime là qu’Annette est le jouet de ses parents, l’objet transitionnel de leur rivalité, le site de leur affrontement. Il faudra que l’enfant-pantin en prenne conscience pour être, telle Pinocchio, rendu à la chair. Si Annette va de l’inanimé à la vie, le bébé de Titane, à l’inverse, va de la chair à l’acier. Né de la liaison entre une humaine et une voiture, son ossature est de métal. C’est un bébé cyberpunk. Mais la plus hybride des enfants du festival était assurément Aline, dans les premières séquences du film de Valérie Lemercier. L’actrice-réalisatrice joue son personnage à 5 ou 6 ans et son corps numérisé est réduit à une taille d’enfant, son visage rajeuni, la proportion entre sa tête et son corps modifié par la puissance des effets digitaux. L’enfant à Cannes 2021, c’est le vecteur par lequel l’humanité s’achemine vers son devenir post-humain.
La voix des morts
Dans Drive my car, l’acteur répète en voiture son rôle dans Oncle Vania grâce à l’enregistrement de la pièce qu’a réalisé sa compagne qui lui permet de lui donner la réplique. Plusieurs années après la disparition de celle-ci, il écoute en boucle cet enregistrement, qui n’est plus simplement utilitaire, mais devient une petite cérémonie. Dans Tre Piani, le juge interprété par Nanni Moretti enregistre le message de son répondeur téléphonique. Quelques années après sa mort, son épouse appelle son propre numéro pour réentendre la voix de son mari défunt invitant à enregistrer un message et elle s’adresse à lui, lui racontant mille choses de sa vie quotidienne, poursuivant oralement leur conversation conjugale au-delà de la séparation. Il suffit d’une petite cassette audio pour suturer l’espace des morts et des vivants. Les fantômes sont d’abord des voix. Ou alors un son. Comme dans Memoria d’Apichatpong Weerasethakul, où d’étranges détonations se transmettent entre les générations et les espèces.
Triomphe du dessin
Un métier aura dominé la sélection cannoise cette année : dessinateur·rice (ou peintre·sse). Professionnel·les dans La Fracture, La Fièvre de Petrov, Les Intranquilles, The French Dispatch, Julie (en douze chapitres) ; ou amateur·trices dans Compartiment 6 ou Flag Day, des barbouilleur·euses de toutes sortes se sont illustré·es sur la Croisette. Dans le premier cas, c’est une façon de mettre en scène les affres de la création et de la représentation sans faire directement un film sur le cinéma (Corsini, Serebrennikov, Lafosse, Anderson ou Trier). Chez Kuosmanen ou Penn (ou aussi chez Corsini, avec la dessinatrice bourgeoise offrant son portrait au Gilet jaune), le dessin est utilisé comme un signe d’affection, comme un cadeau pour dire son amitié ou son amour. En 2019, le Portrait de la jeune fille en feu avait su synthétiser ses deux tendances.
>> À lire aussi : “La Fièvre de Petrov” de Kirill Serebrennikov : un hallucinant train fantôme à travers la Russie post-soviétique
La forme série
Si en 2017, le Festival de Cannes accueillait pour la première fois deux séries (Twin Peaks S3 et Top of the Lake S2), la création l’année suivante de Canneséries établissait une ligne de démarcation claire entre cinéma et série. Et pourtant, certains films vus cette année portaient en eux la trace de l’écriture et de la mise en scène propre aux séries. Si tenté qu’il doive disputer aux séries la place de première forme audiovisuelle (match qu’il semble avoir définitivement perdu à l’occasion du confinement), le cinéma vu cette année à Cannes se défend en adoptant deux attitudes, soit des partis pris insulaire fou (Annette, La Fièvre de Petrov, Titane, Memoria), soit une technique de cannibalisation de l’écriture sérielle. Ainsi, en sortant de Julie (en douze chapitres), de Les Olympiades, de Drive My Car ou de The French Dispatch, on eut le sentiment de sortir d’une ou de plusieurs saisons d’une série.
Le recours au récit fragmenté (Julie (en douze chapitres)), à une temporalité étirée (Drive my car), à la forme de l’anthologie (The French Dispatch), une condensation de péripéties (La Fracture, version compressée d’Hippocrate), des ressorts proches de la telenovela (Tre Piani) et une efficacité dramatique conjuguée à une mise en scène quasi-blanche, mais opulente (Les Olympiades) en sont les signes les plus visibles.
>> À lire aussi : “Tre piani”, le nouveau film sombre et cruel de Nanni Moretti
De grands gestes insulaires
À Cannes, au-delà des motifs et thèmes récurrents, au-delà du cinéma comme sismographe des états du monde, certains gestes de mise en scène sont apparus dans toute leur majesté insulaire. Insulaires car ne ressemblant à aucun autre, mais pas nombrilistes, au contraire. Si Nadav Lapid met en scène un alter-ego dans Le Genou d’Ahed, les soubresauts incontrôlés de sa caméra disent quelque chose de la colère trop longtemps contenue face au fascisme qui revient, tandis que Kirill Serebrennikov nous plonge dans un délirant labyrinthe mental arrosé de vodka pour raconter sa Russie autoritaire.
Leos Carax (récompensé par un prix de la mise en scène mérité) ne parle que depuis son empire intérieur, mais fait écho à l’insupportable violence contre les femmes, et Apichatpong Weerasethakul, comme à son habitude, déploie ses plans shamaniques pour nous faire ressentir, en creux, la violence politique et sociale, passée et présente, des lieux qu’il filme (en l’occurrence la Colombie). Julia Ducournau utilise, elle, tous les effets du genre (thrill, mutations, gore…) pour faire exploser la binarité du genre et défendre, avec une radicalité bien heureusement récompensée, les monstres, tous les monstres. Mais c’est à Arthur Harari, injustement boudé par le jury d’Un Certain Regard (mais adoré par la presse et le public cannois), que le terme insulaire convient sans doute le mieux, puisqu’il raconte, avec son classicisme puissant et jamais académique, l’isolation sur une île d’un forcené qui refuse d’accepter que le monde change.
La vie en chantant
Entre Annette de Leos Carax, Tralala d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Suprême, biopic du groupe NTM signé Audrey Estrougo, The Velvet Underground par Todd Haynes ou encore Aline de Valérie Lemercier, déclaration d’amour à Céline Dion, le film musical constituait l’un des motifs récurrents de cette 74e édition affirmant ainsi par le chant une manière de contourner la “tyrannie” du réel. D’autres films, eux, ont utilisé la chanson comme des climax, moments de suspension pour fixer la vengeance d’une jeune fille abusée sur Shame On You dans Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurisse ou pour réactiver le souvenir d’un premier amour dans Bergman Island de Mia Hansen Løve (The Winner takes it all d’Abba).
Mais c’est peut-être dans le méta et lumineux Journal de Tûoa de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro, film de confinement, mais film à l’air libre, que The Night de Frankie Valli & The Four Seasons, assurément le son du festival, trouvait sa plus belle utilisation : ouvrant et refermant un film sur une scène de danse collective, pour ne plus craindre “les heures solitaires”. If he always keeps you dream in You won’t fear the lonely hours.